Bien trop aimer les femmes perdues
- Emmanuel Bing
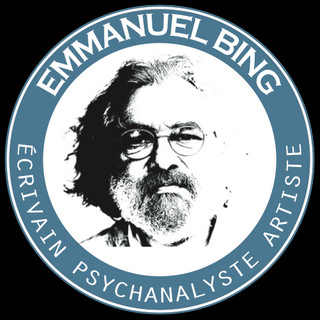
- 26 août 2025
- 4 min de lecture
On veut écrire : éteindre la télévision. Sortir absolument de l’information. Sortir du monde, ne pas savoir, ne pas trop savoir. Profiter encore de l’été. Après le 15 août tout se dégrade toujours. Le temps, les nouvelles, les prix. Profiter ? Je n’ai jamais aimé l’idée. Peut-être que l’idée de profit a été dévalorisée durant mon adolescence, dans les années soixante-dix, quand tout encore était politique. Dommage sans doute. Façon de tirer son épingle du jeu, j’en suis bien incapable. Heure où les démons vous rattrapent ; j’ai toujours dans l’œil la lumière d’une lune vieille.
Clisson cet été. J’y allais pour le Moyen-Âge, les ruelles anciennes, les ruines du château, mais la ville est prise dans les rets du festival de heavy métal qui se déroule en juin, je n’en avais pas l’idée. Seulement la chanson de Gilles Servat en tête, la voilà la Blanche Hermine, vive la mouette et l’ajonc, la voilà la Blanche Hermine, vive Fougères et Clisson !
On veut écrire : la rumeur du monde s’amplifie. Ma mère craignait le bruit des avions. Look mammy, there is no plane up in the sky. Les traumatismes de l’enfance de Roger Waters. Sa mère devait avoir peur des avions elle aussi, si l’on en croit l’album de Pink Floyd, et le film grandiose, The Wall. Je fais toujours remarquer que l’une des premières scènes du film, qui se passe dans un square avec des jeux d’enfants, et où le petit garçon en manque de père prend un adulte par la main pour faire quelques pas avec lui, scène émouvante, a été filmée à hauteur d’enfant, tout comme L’opoponax de Monique Wittig a été écrit à hauteur d’enfant, fait rare qui lui valut une belle postface de Duras. La rumeur du monde s’amplifie, et sans que j’en puisse mais le son d’un avion dans le haut ciel me grave en mémoire la terreur de la guerre. Elle pèse sur nos mots, elle pèse sur nos pensées, elle pèse dans nos rêves.
On veut écrire, il ne faut pas allumer la machine infernale. Rester encore dans l’odeur des blés et des bruyères, dans le chant des grillons, des oiseaux, des cigales, de la vague au loin, du vent dans les branches, dans le silence des montagnes. Le stoïque dirait : il faut désirer ce qui arrive. Mais ce qui arrive c’est aussi cela, le vent dans les arbres, le pétrichor après la pluie. Rien de nouveau sous le soleil. Mais rien de solaire dans le nouveau.
On veut écrire, garder en tête la mélodie d’un violon, dans une chapelle perdue sur une colline râpée d’herbes sèches. Entendre craquer les portes. Ne plus jamais dire il faut, il faut quelque chose, il faudrait quelque chose, et ce que nous aurions dû faire et que nous n’avons pas pu. Laisser croire que le désordre c’est l’ordre, et mettre sa vie en désordre pour s’empêcher de mourir. Je lis le livre de cette femme, croisée sur le réseau. Marie-Laure Dagoit, Le dédain. Très beau livre. Elle avertit : il contient de la pornographie. Elle me fait penser à une autre, à quelques autres avec qui j’ai partagé des lits, des heures, des paroles, des chansons, des poèmes et des livres. Des femmes qui écrivent. D’anciennes de qui je me suis enfui, par qui j’ai été quitté, laissé sur le bord de mon chemin à moi, sans autre forme de poésie. Je sens cette violence qui déborde. C’est aussi cette mère que j’ai eue, dans sa violence et sa folie, cette mère érotisée à l’extrême et carnassière et violente, cette mère que j’écris dans mes livres, ou qui en disparaît pour me laisser vivre.
Toute œuvre est partie d’une œuvre plus grande, toujours infinie, toujours inachevée. Une œuvre intolérable tant par sa complexité que par son incomplétude. Parce que l’œuvre c’est aussi le geste même, le mouvement, la respiration, quelque chose qui diffuse dans l’air et disparaît, éphémère.
J’aimais bien trop les femmes perdues, dans ma jeunesse d’étudiant, quand la petite colombienne me téléphonait à trois heures du matin, saoule, et qu’elle ne demandait rien que sa parole ivre et sa solitude lasse, qu’elle allait si mal à cause de son exil, et que je ne savais plus quoi lui dire et que, tout de même, elle ne pouvait pas venir dans la nuit. Ma propre jeunesse perdue, pas la même que celle de Modiano, même si je fréquentais le même café inconnu, et le même quartier qu’il ne veut pas décrire, citant seulement le nom des rues. J’avais vingt ans et j’ensauvageais ma dégaine rue de l’Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, poursuivant le fantôme d’Apollinaire, ou de Verlaine, à la rencontre d’une femme perdue dont le regard brumeux m’aurait terrifié, la cigarette au coin des lèvres et l’incertitude à vivre. Ce sont ces souvenirs du vivant, de ce vivant d’autrefois, avec tous les avenirs possibles. C’est cela, la nostalgie. Le souvenir des avenirs possibles. Formes délaissées et brumeuses de l’avenir. C’est ce qu’éveille en moi Le dédain de Marie-Laure Dagoit, dont je ne dis pas qu’il faut le lire, je dis seulement que c’est possible, un soir ou l’autre, comme une rencontre furtive au détour d’une page.
Une dame derrière son comptoir m’a proposé l’entrée gratuite au château de Clissons : dans les ruines, avec ma canne, je ne pourrais aller partout. Mon âge a bien augmenté d’un cran cet été encore, même s’il n’est pas canonique. Les ruines me parlent toujours. Ces gens jetés dans le puis pendant les guerres de Vendée, les tours sombres et creuses et les lieux racontés, pleins de batailles et d’amours anciennes. En haut d’une tour une jeune fille aux longs cheveux blonds, envoyant sa blondeur dans la brise sèche et molle par une ouverture, appelant pour que l’on vienne la sauver en s’agrippant à sa chevelure. Le rire de la princesse, peut-être celui-là même de Jeanne de Belleville, pirate par vengeance de l’assassinat de son époux, Olivier de Clisson.
On veut écrire, peut-être, au souvenir d’une femme perdue.
EB - 22 août 2025 La lettre du chardon n°65 Un grand merci à mon magnifique modèle, Valentine S |







Commentaires